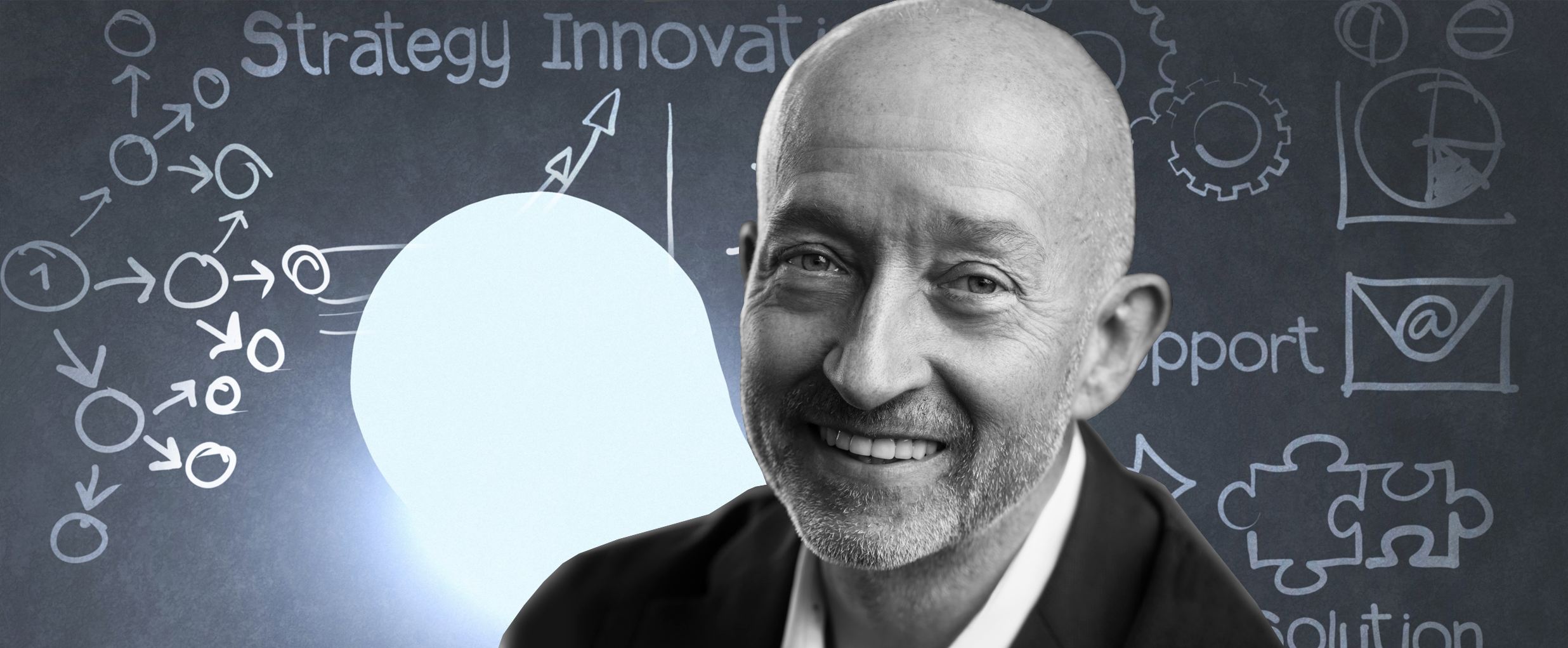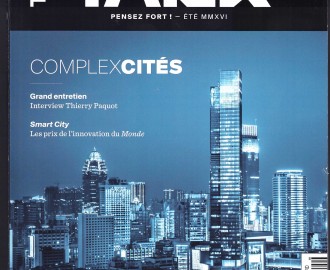Logocities – Villes à vendre
Il fait déjà chaud. Une atmosphère joyeuse parcourt la ville. » Good morning life ! « , Dean Martin salue de sa voix de crooner cette fourmilière ensoleillée qui s’agite de l’aube jusqu’à la nuit. Tout est harmonieusement géré, normé, standardisé. Et Los Angeles égale à elle-même : géométrique, immense, parcourue d’échangeurs autoroutiers dans tous les sens, – un shot de business et de bonne humeur. Un détail retient l’attention : les humains… qui sont-ils? Des clones ? Des post-humains ? Les réplicants échappés de Blade runner ? Moitié humanoïdes moitié figurines publicitaires, les marques les ont hybridés.
Parmi ces marionnettes on reconnaît un camionneur PRINGLES, une pin-up ESSO, un guide Mr PROPRE, les M&M’s se tenant par la main, des enfants à tête de BIC. Et quand ils n’ont pas l’allure d’une mascotte, les passants sont réduits à des silhouettes sans identité, interchangeables. Des papillons MICROSOFT passent, un couple d’oiseaux BENTLEY et ASTON MARTIN s’envole, le lion de la METRO GOLDWIN MAYER prend le soleil. Les objets ont eux aussi été métamorphosés : cigarette AIR FRANCE, pompe à essence DIESEL, gratte-ciel COLGATE, pont AUDI, château HARRY POTTER, route VAIO etc. Les feux de signalisation règlent la circulation avec des messages qui ne sont plus rien de subliminal (STOP&SHOP), le soleil MALIBU brille de tous ses feux, les palmiers AFRI-COLA prodiguent leur ombre bienfaisante, la montagne EVIAN rafraîchit l’horizon, les champs sont semés comme la doublure à carreaux BURBERRY, la roche souterraine porte la mention THE NORTH FACE. Vue du ciel, la presqu’île de la Californie du Sud a pris la forme de la virgule NIKE. Dans un ultime clin d’oeil, l’espace intersidéral est parcouru par les planètes PEPSI-COLA et MASTERCARD, le logo NASA tourne comme un satellite, MILKYWAY a pris la place de la voie lactée. Tout est fake, y compris l’océan Pacifique dont la couleur a été rehaussée jusqu’au bleu pantone désiré…
Ce scénario de marketing-fiction s’intitule LOGORAMA, court-métrage d’animation dans lequel la ville de Los Angeles a été entièrement reconstituée avec des logos. Les réalisateurs en ont sélectionné 3.000, ce qui correspond au nombre de marques qu’en moyenne un individu percevrait chaque jour. Résultat saisissant, inquiétant par certains côtés : il est possible de rebâtir intégralement Los Angeles, ses habitants et son environnement sous l’angle des marques.
Nous voici donc tels que nous aurons muté, dans la smart city à venir. Notre avenir consistera-t-il à évoluer dans un parc d’attraction où l’humanité sera supplantée par des mascottes ?
LOGORAMA[1] ne se contente pas de figurer un monde imaginé dans une agence de design. Le court-métrage contient une intrigue qui met aux prises deux Bibendum MICHELIN (les flics) et Ronald, le clown de Mc DO, dans la peau d’un killer psychopathe. Les cops prennent en chasse le bastard. Après un accident de voiture, Ronald prend en otage le gamin HARIBO, se barricade et tire sur tout ce qui bouge. Puis s’échappe sur une moto de marque GREASE et vient heurter un camion WEIGHT WATCHERS. A la fin le sol se met à vaciller : un tremblement de terre détruit la ville, allusion au » Big One » qui est censé se reproduire à Los Angeles depuis qu’est survenue la catastrophe de 1906. Le pétrole jaillissant de toutes parts engloutit les emblèmes de cette civilisation de la surconsommation sous une épaisse marée noire. Le sol se crevasse en croix X-BOX, les building-marques s’effondrent les uns après les autres, le pétrole s’échappe de la terre éventrée et recouvre tout. Quelques marques voguent à la dérive. Fin de la fiction-catastrophe.
L’utopie de LOGORAMA rappelle le best-seller de Breat Easton Ellis, American Psycho, dans lequel le personnage principal, un trader yuppie de Wall Street, n’achète que des marques à la mode. Au fil de l’histoire, il se révèle être un serial killer. Marques et violence, le couple maudit est une nouvelle fois mis en scène : quand les objets l’emportent sur le vivant, quand les signes extérieurs étouffent la liberté d’être soi et empêchent de vivre sa singularité, quand la consommation est devenue le sens de la vie, quand la ville est une galerie marchande, le passage à l’acte violent devient une conséquence psycho-logique. Nous voici donc tels que nous serons peut-être un jour, – » marqués » jusqu’au bout des ongles, » brandés » sous toutes les coutures, logotypés comme des paquets de biscuits livrés sur palette dans les hypermarchés. Voici le monde que nous aurons chosifié, » designé « , reconstruit comme un storytelling de marque. Plus un seul espace vierge, tout sera surconsommé dans une ville franchisée qui ressemble à un immense mall. Vision ironique du monde actuel grâce au détour de l’utopie ou vision prophétique de mauvais augure, peu importe ! La ville ne vivra jamais plus sans les marques ni la violence de leurs excès.
Chacun tirera sa conclusion de cette fable qui commence sur un air joyeux et finit par une chanson contenant une ultime dénégation : » I don’t want to set the world on fire / I just want to start a flame in your heart_ « . Les uns, dans un fantasme de justice immanente, y verront un remake du déluge biblique qui s’abat sur une humanité consumériste châtiée pour ses excès. Les autres, en souvenir de Fukushima, rappelleront qu’on ferait mieux de s’occuper de la planète au lieu de laisser les hommes avides construire des châteaux de sable. D’autres encore, acquis ou résignés à la cause du marketing, ne manqueront pas de souligner que, d’ores et déjà, les marques sont partout, occupent définitivement nos vies, les choses, les lieux, le temps… et qu’elles nous ont transformés depuis longtemps en hommes-sandwichs, à notre insu ou avec notre consentement collectif.
Pour ma part, après avoir salué le talent imaginatif des auteurs de LOGORAMA, je préfère y lire une fable des temps modernes et regarder dans ce miroir grossissant notre culture des marques. Los Angeles, ville franchisée, est déjà partout : galerie marchande du Louvre, Parly 2, shopping mall des sous-sols à Hong Kong, logos flashs de Shanghai, Shibuya etc. Dans tous les centres-villes des capitales européennes se retrouvent les mêmes boutiques des mêmes chaînes (H&M, Apple Store, Zara, Subway, Mac Do, Starbucks…). Dans toutes les périphéries urbaines les magasins des franchisés tentent paradoxalement de recréer l’ambiance singulière des magasins d’autrefois (boulangeries Paul).
Quant aux mascottes, ce sont les consommateurs qui règlent leur vie et leurs comportements selon la vision des marques auxquelles ils adhèrent. On est Apple, on roule allemand, on a Harley Davidson dans la peau, on se sent chez soi chez Monop’, on se reconnaît dans Chanel, on rêve de Dior, on a le réflexe leboncoin, on se lève à l’heure de vente-privée, on vit la ville comme un Smarter qui se faufile partout et se gare en épi, on calque sa vie et ses relations aux autres comme dans une pub d’Abercrombie & Fitch, on ne boit pas un café chez Starbucks, on y donne rendez-vous à ses amis.
Le branding généralisé a envahi les villes. L’hybridation est devenue le modèle de bio-conception des espaces : l’architecture intérieure communique à la Saguez, le packaging de Carré Noir ou Dragon Rouge entre dans la catégorie des arts plastiques, les Starbucks sont des salons, les stades de foot sont des espaces multimédias, les tours des oeuvres d’art, les magasins des show-rooms. Jamais l’infiltration du branding n’était allée aussi loin, marquant le moindre espace, et s’appropriant en retour les codes de l’art, de la musique, de la nature. La labilité des frontières est devenue la norme, tout est clin d’oeil et allusions dans un perpétuel jeu où le décodage compte plus que la consommation elle-même.
Mais le séisme final de Logorama viendra peut-être d’un contre-poison : les marques neutres. Ce que j’aime, quand je prends un taxi Uber, c’est qu’il n’y a pas de logo sur les portières et que les véhicules sont banalisés. Ce que j’aime avec Airbnb c’est que je n’entre pas dans un hôtel qui clignote jour et nuit mais dans une maison. Ce que j’aime dans le financement participatif de Kickstarter c’est que le logo noir et rouge de la Société Générale ne me saute pas à la tête sur chaque page web… La ville de demain sera parcourue par cette opposition entre le clinquant et l’anonyme. A chacun de choisir sa ville.
Pierre-Louis Desprez
article paru dans TANK – Eté 2016 – n°17
[1] Réalisé par François Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic Houplain (collectif H5) en 2009. Oscar du meilleur court métrage d’animation en 2010, César 2011