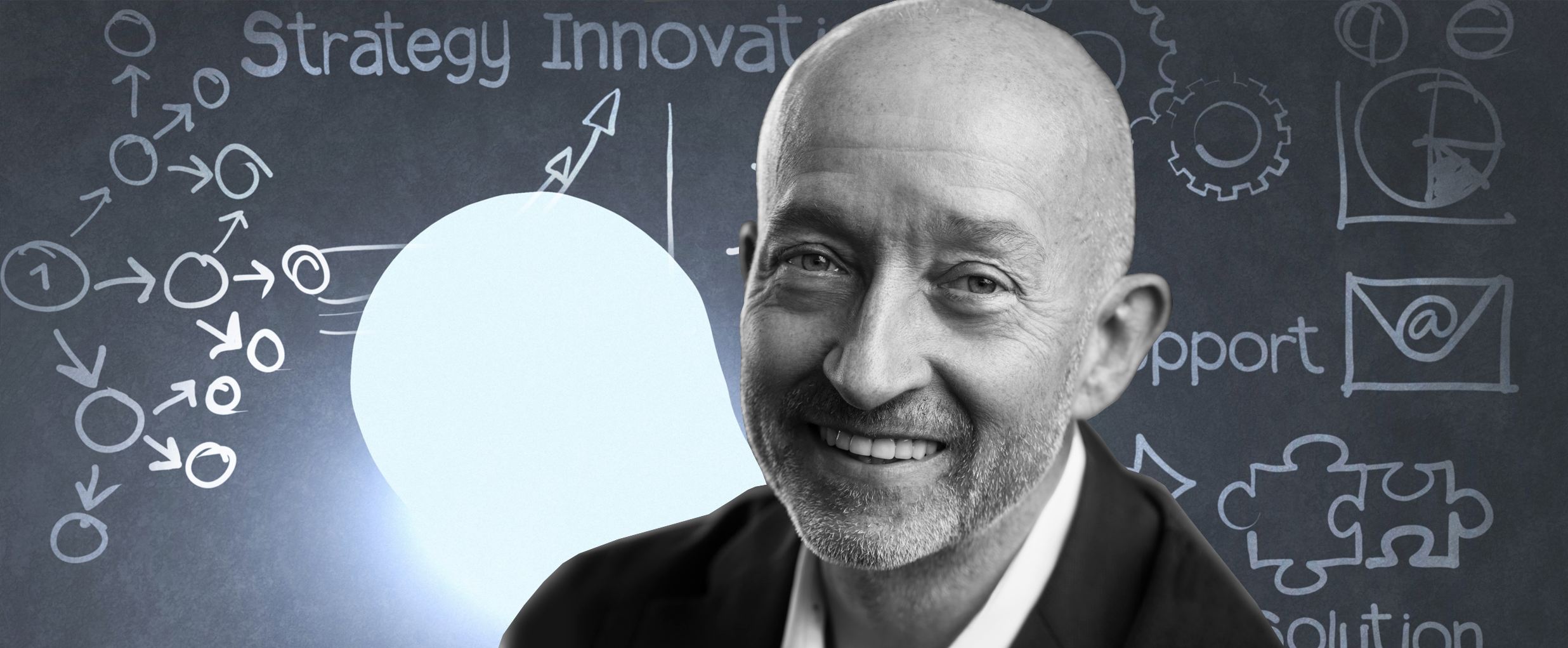ÉCONOMIE & SOCIÉTÉ
Les Echos – 09/04/2013
L’optimisme, faute de mieux ?
LE CERCLE. Dans un monde en proie au doute, consommer est devenu une manière de conjurer son (triste) sort et un indice susceptible de mesurer l’optimisme d’une population. Y a-t-il pour autant matière à s’en réjouir ?
Crisis ? What crisis ? C’est sous ce titre que sortit en 1975, sur fond de double choc pétrolier, un album de Supertramp caractérisé par une étrange pochette : un homme en maillot de bain, seul, bronzant sous un parasol orange. Près de lui, une radio, une table avec un verre ressemblant à un coca rondelle et un magazine. À l’arrière-plan, un paysage tout gris, des maisonnettes collées les unes aux autres, des usines, des centrales électriques, des dizaines de cheminées crachant leurs fumées et des vents balayant le ciel d’est en ouest. Dépression garantie s’il n’était cet homme, symbole vivant d’un divorce entre l’environnement extérieur et le monde intérieur, capable de mettre de la couleur dans la grisaille autour de lui en écoutant de la musique.
Quarante ans plus tard, sans parler du pouvoir quotidien qu’a pris la musique, il reste de cette pochette une idée, intacte : à chacun de façonner sa bulle pour supporter le réel et vivre sa vie, ce qui pourrait être la définition de notre optimisme contemporain. Comment en est-on arrivé à cette nouvelle forme de paradis artificiel ? Pourquoi, pour vivre mieux, faut-il se raconter une histoire ?
À chacun son bonheur
Notre civilisation s’est construite sur la promesse eschatologique de la religion. Pour des générations entières, le salut devait advenir dans une autre vie. Les actions humaines prenaient leur sens moral par rapport à cet horizon meilleur, et différé dans l’au-delà. Mais Dieu mourut. Il mourut même en Allemagne, sous la plume de Nietzsche, en pleine suprématie bismarckienne, et face à la force de la machine et du mark qui devaient assurer l’unification de l’Empire. Avec lui disparut la mythologie d’une existence récompensée après la vie sur terre. L’individu fut sommé de construire des valeurs par sa volonté propre. Elles devaient lui permettre de s’adapter à ce siècle de fer. En même temps qu’il s’essayait à bâtir cet homme nouveau, on lui proposa un divan, pour l’aider à curer ses angoisses existentielles et surmonter les intermittences de la confiance en soi. Mais deux guerres vinrent terrasser les projets des surhommes qui avaient surgi de tous côtés.
Les nouvelles frontières de l’optimisme
Les constructions politiques prirent le relai de la métaphysique incertaine et de la puissance aveugle de la volonté. Apparurent alors les Realpolitiks, en prise directe avec l’époque : d’un côté le marché, de l’autre la planification. À l’est comme à l’ouest la promesse était forte : le grand soir adviendrait après une journée de lutte intense et solidaire, ou bien chacun profiterait du progrès durant son vivant. De chaque côté le temps long fut ainsi ramené à l’échelle de nos vies. Un président américain promit même la lune durant sa mandature ! En quelques années seulement on foulerait le sol de l’astre sur lequel les hommes avaient si longtemps projeté leurs interrogations scientifiques et philosophiques, leurs superstitions et leurs sentiments romantiques. Il suffisait de définir une ambition non plus métaphysique ni idéologique, mais technique, d’y mettre les moyens, de fixer un plan de marche et d’entrer dans la compétition géopolitique de qui réussirait le premier entre Khrouchtchev et Kennedy.
L’optimisme, du besoin au devoir.
Ce raccourcissement du terme – de l’au-delà au quotidien – modifia simultanément notre représentation du bonheur : on le voulut ici et maintenant. L’impératif à jouir sans entraves, écrit sur les murs de 68, devint l’objectif de toute vie. Les délais entre le désir et sa satisfaction ne cessèrent de diminuer, au point d’en devenir quotidiens. Le bonheur perdit son statut intimidant pour faire place à une posture individuelle : l’optimisme comme état d’esprit permanent était né. Fabriquée de façon autonome par chacun d’entre nous, cette nouvelle philosophie de vie dans laquelle nous baignons fit recette : puisque nous sommes seuls, sans utopie ni grand projet, cherchons le côté positif des choses, sublimons l’instant !
La pochette de Supertramp annonçait l’arrivée d’un homme nouveau : l’optimiste. Un homme capable de convertir le mauvais en meilleur, l’accident en opportunité et la crise en innovations. Les valeurs qui l’animent sont la joie minuscule (une gorgée de bière), l’émerveillement par la relativité (fréquenter des amis), le souvenir des bons instants, le plaisir de vivre malgré tout. L’optimisme, c’est ce qui nous reste de l’espérance après que le rêve des grands lendemains a fait faillite.
Le marketing de l’optimisme bat son plein
Depuis longtemps, les marques ont perçu la précarité de cet optimisme que le temps a émoussé facilement. Elles en sont devenues l’alliée au fur et à mesure qu’elles prenaient conscience de leur pouvoir émotionnel sur les individus. Sous leur emprise, la joie de consommer a remplacé le simple besoin, l’achat est devenu une expérience de plaisir. En 1988 Carrefour lança son “je positive !” : depuis lors, ce slogan consumériste nous sert de méthode Coué dans un environnement mondial qui va de crise en crise. Au point que toute expression formulée négativement est rejetée pour être traduite en “positive langue”. Le cas le plus emblématique est celui de Coca-Cola, “la” marque parmi les marques qui vend plus d’un milliard de bouteilles chaque jour. Depuis quelques années sa communication globale a été repositionnée autour du bonheur : “Open happiness”, “Ouvre du bonheur, ouvre du Coca-Cola”, “The happiness factory”, etc. Aboutissement logique d’une saga commencée avec les vertus médicamenteuses du soda, puis le Père Noël et dont le précédent slogan contenait en creux une définition de l’optimisme : “Coke side of life”. Préférer le bon côté de la vie et rejeter les autres : le bonheur se produit comme on choisit une canette. On en pleurerait de joie, pour parler comme Perrier après l’affaire du benzène aux États-Unis.
Souriez, vous consommez !
On ne compte plus les logos qui arborent un sourire, tels ceux de Amazon, Laser, PagesJaunes, Kraft etc., ni les programmes de “fid’” qui attribuent des Smiles à la pelle, ni les campagnes qui vantent le bonheur des individus au Club Med ou celui des chiens avec mangeant les croquettes Friskies. Ronald, le clown de McDonald’s, associé à Happy meal dès 1963, ne se doutait pas qu’il aurait une postérité aussi nombreuse. On pourrait remonter encore plus loin dans le temps, vers Dale Carnegie et sa méthode pour se faire des amis, ou vers la naissance du storytelling à l’américaine lorsque les prospectus scénarisaient la transformation miraculeuse des individus préférant une marque à une autre. Tel ce cri de joie pour promouvoir, dès 1926, les leçons de piano par correspondance de l’U.S. School of Music : “They laughed when I sat down at the piano – But when I started to play!” Clin d’œil diront les plus optimistes, opium répondront les plus cyniques.
L’optimisme est devenu le territoire de prédilection des love brands et de celles qui prétendent nous aspirer au-dessus de la transaction marchande. Pour laisser une bonne trace dans nos cerveaux, les marques se sont appropriées les deux émotions humaines les plus compatibles avec leur ambition commerciale : la joie et la surprise. De fait, c’est la recette de l’optimisme : se surprendre soi-même et son entourage en transformant en petites joies les événements quotidiens. Et Dieu sait si, dans cette Europe actuellement déprimée, il est besoin de convertir la boue en or ! C’est le paradoxe final : pires sont les nouvelles du monde extérieur, plus lourd devient le travail intérieur de l’optimiste, et plus les marques peuvent l’aider en jouant leur rôle de cosmétisation. Voilà au moins un marché en croissance, celui de l’optimisme… par défaut.