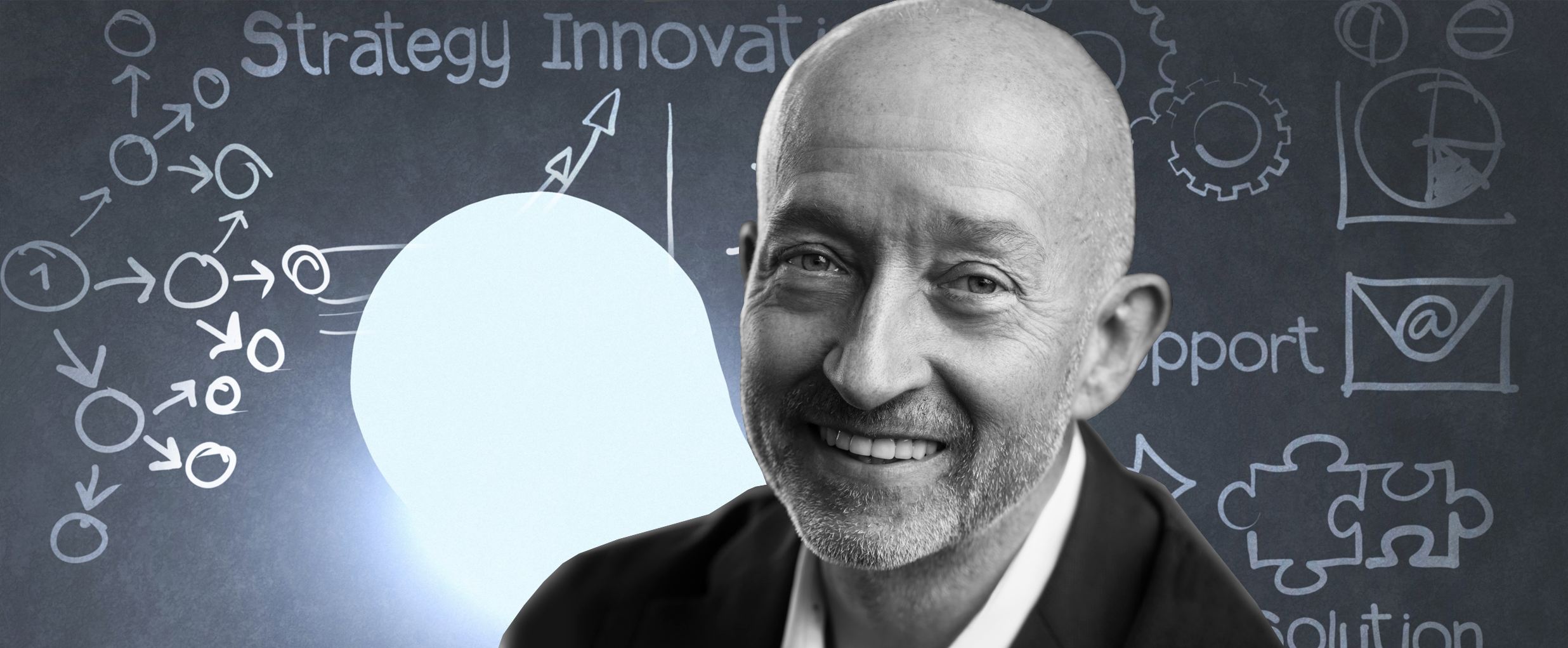Value for money
Les nouvelles exigences marketing nées de la crise. Par Caroline Castets
Article paru sur lenouveleconomiste.fr – 29/08/2013
La crise n’en finit pas et pour y faire face, les marques vont devoir faire preuve d’inventivité afin de répondre à une double exigence de rigueur sur les prix et de créativité sur la valeur. Car en dépit des problématiques pourtant omniprésentes de pouvoir d’achat, le consommateur n’est pas dans une attente dite de “contrat minimum” – du prix bas et rien d’autre – mais, à l’inverse, en quête d’un surcroît de valeur. D’un avantage identifié pas nécessairement rationnel – du type fonctionnalités supplémentaires ou praticité accrue – mais suffisamment fort pour justifier l’acte d’achat. Une “prime”.
Au plaisir, à l’interactivité, à la proximité… à tout ce qui sera susceptible de combler les carences créées par la crise, de redonner du pouvoir au consommateur et, au passage, de dé-diaboliser un univers de la consommation qui, après avoir longtemps suscité l’envie, inspire aujourd’hui surtout la défiance.
Le gouvernement a beau multiplier les démonstrations d’optimisme et répéter sa foi en une reprise imminente, force est de constater que, pour l’heure, le message peine à convaincre. Et pour cause. Entre un pouvoir d’achat au point mort, des impôts en hausse et des allocations en baisse, on cherche en vain les motifs de “réassurance”; ces signaux objectifs censés restaurer la confiance des ménages et, de fait, relancer la consommation.
C’est donc avec ce climat dégradé, plus propice à l’instinct de préservation qu’à l’achat d’impulsion, que les différents acteurs du marché et leurs directions marketing devront, au cours des prochains mois, composer. Actionner les leviers et imaginer les messages qui permettront, en dépit de la morosité ambiante, de l’absence de visibilité et des innombrables inquiétudes du moment, de “déclencher l’acte d’achat”. Mission complexe mais pas impossible pour ceux qui, estiment les experts, sauront tirer parti du contexte actuel. A savoir : identifier et exploiter les exigences que la crise a fait naître autant que les carences qu’elle a suscitées.
Feuille de route et décryptage.
Les attentes contraires: rigueur et créativité
Premier de ces impératifs post-crise, celui qui consistera, à l’avenir, à gérer deux attentes contraires : celle de la rigueur et de la créativité. A l’origine de cette exigence a priori paradoxale et désormais décrite comme incontournable, la conjonction de plusieurs réalités. Celle de la crise et de ses effets concrets sur le budget des consommateurs et celle de leur volonté, désormais impossible à ignorer, d’accéder à un contenu à la valeur parfaitement identifiée. Autrement dit : finis les innovations de façade, l’habillage marketing et les fausses promesses ; désormais, toute marque devra être en mesure de justifier la valeur qu’elle revendique. Pour cela, explique Pierre-Louis Desprez, directeur général de Kaos Consulting, beaucoup vont devoir inventer un nouveau marketing, “capable de répondre à cette exigence forte de prix maîtrisés tout en préservant, voire en augmentant, la valeur de l’offre”. Rigueur et créativité, donc.
Beaucoup n’ont pas attendu la rentrée 2013 pour intégrer cette double exigence à leur cahier des charges et en tirer profit. En tête des bons élèves, des distributeurs inspirés tels que Décathlon, Boulanger ou encore Ikea qui, depuis des années déjà, cultivent avec succès l’art de manier le paradoxe en mixant valeur d’usage élevée et tarifs maîtrisés. De quoi leur assurer aujourd’hui une réelle longueur d’avance car à en croire Pierre-Louis Desprez, une chose est désormais certaine : “Les gens ne sont plus prêts à payer pour du pur story-telling ; celui qui permettait au produit de raconter une histoire sans apporter un vrai plus.” Le diagnostic est sans appel : désormais, pour se justifier, tout achat devra comporter une dimension utilitaire.
Que celle-ci se mesure sur le strict plan rationnel – fonctionnalités supplémentaires, praticité accrue, innovations véritables… – ou pas. Car si, encore une fois, la crise et ses innombrables répercussions conditionnent les comportements d’achat, leurs effets ne se limitent pas à une simple volonté de prix bas. Loin s’en faut.
Le surcroît de valeur
Si c’était le cas, les hard-discounters domineraient l’ensemble du marché. Or pour se maintenir, la plupart se trouvent dans l’obligation d’introduire des produits de marques nationales dans leur offre. Preuve que le consommateur attend autre chose que du prix. Une valeur ajoutée adaptée aux contraintes du moment ; de quoi compenser les carences imposées par le contexte actuel.
Pour Michel Perret, directeur en charge de la stratégie chez Leo Burnett, l’analyse est simple : le consommateur a changé. Il veut plus que ce que la plupart des marques étaient jusqu’à peu en mesure de lui offrir : plus de sécurité (autrement dit, de capacités de contrôle et de transparence), plus de plaisir et plus de valeurs. En clair et en dépit des problématiques de pouvoir d’achat, “il n’est absolument pas dans une attente de “contrat minimum” avec les marques”. Au contraire, il est désormais prêt à payer pour un surcroît de valeur. Un avantage identifié et avéré et, encore une fois, pas nécessairement d’ordre rationnel que Michel Perret appelle “une prime”.
Concept autour duquel, selon lui, les stratégies de marques devront à l’avenir se penser. Motif ? Le besoin est à la fois réel et urgent. “Ce qui est flagrant dans la société actuelle c’est le manque de perspective, explique-t-il. Dans ce contexte bouché, les marques qui seront capables de suggérer un avenir – individuel, environnemental, sociétal… – et ainsi de créer, d’une façon ou d’une autre, un espace d’optimisme, marqueront des points.”
Pour y parvenir, les leviers ne manquent pas. Parmi les recettes gagnantes on trouve notamment la prime au plaisir – un grand classique en période de crise et donc, de quête de réconfort qui explique que les ventes de marques telles que Lindt, résolument positionnées sur la gourmandise, explosent à chaque durcissement de la conjoncture – et, dans la même veine, la prime à la régression, autrement dit, à toute forme de consommation qui permettra, un instant, par son côté décalé et ludique, d’échapper aux sujets graves. Une tendance qui se vérifie particulièrement dans l’alimentaire – 50 % des consommateurs de céréales pour enfants étant aujourd’hui des adultes et la dernière campagne Haribo mettant en scène des adultes qui retombent en enfance – mais aussi dans le domaine des loisirs où l’âge moyen des acheteurs de jeux vidéo – qui n’a cessé d’augmenter au cours des dix dernières années – atteint aujourd’hui 33 ans et, où, plus anecdotique mais non moins révélateur, un bar parisien baptisé “Zéro de conduite” sert ses cocktails dans des biberons.
Autre levier à actionner et autre “prime” à valoriser, celle que recèle le “do it yourself” dans tous les domaines du quotidien. Du bricolage à la cuisine en passant par la décoration ou les loisirs, Michel Perret est formel : toute marque qui sera en mesure de développer une offre dans laquelle le consommateur disposera d’une “marge d’intervention” – recettes en kit, outillage sur mesure, meuble à customiser… – aura de fortes chances de convaincre. Non pas en raison d’une quelconque forme de repli sur soi, comme cela s’est vu il y a quelques années, mais parce que sa volonté latente d’être “partie prenante” a fini par se transformer en exigence.
La prime à l’interactivité
Contrôler, conseiller, critiquer… en un mot agir sur les marques, leur communication, leur stratégie et même, dans une certaine mesure, leur processus de fabrication, c’est ce que le consommateur cherche à faire depuis des années. Mais depuis que la crise est passée par là, beaucoup estiment que le rapport de force, autrefois favorable aux marques, autoritaires et toutes-puissantes, s’est inversé. D’où la nécessité pour celles qui ne l’ont pas encore fait d’intégrer au plus vite cette réalité afin de tirer profit de ce que Michel Perret appelle “la prime à l’interactivité”.
Celle-ci peut se traduire par la possibilité de personnaliser le produit ou son packaging, comme Coca l’a fait en proposant un packaging aux étiquettes nominatives, M&Ms en permettant l’impression de messages personnalisés sur ses bonbons eux-mêmes, ou encore Fiat en offrant un million de combinaisons possibles (peinture, options, motorisation…) aux acheteurs de sa Fiat 500. Autres leviers d’interaction : permettre à l’utilisateur d’émettre un avis ou une suggestion – ce que certains acteurs du marché, comme Carrefour ou Unilever, cherchent désormais à favoriser en recueillant, via un programme de suivi dédié, les remarques, conseils et idées de certains consommateurs référents – voire de prendre part à la gestion de l’entreprise. Une option qui tend à se développer aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où le modèle “associatif” est en forte hausse dans le domaine de la distribution, comme en témoigne le succès croissant d’enseignes comme The People Supermarket ou Park Slope Food Coop qui permettent à leurs clients d’accéder à une offre très qualitative – locale, bio… – et bon marché en échange de quelques heures de leur temps consacrées chaque mois à la gestion de l’enseigne.
Rien d’étonnant à cela, estime Michel Perret pour qui tout ce qui est de nature à permettre une intervention sur le produit, le packaging, le message ou même les orientations de l’entreprise et ainsi à augmenter l’interactivité marque-consommateur est extrêmement recherché. Au point de fournir un véritable boulevard aux marques qui, pour beaucoup, ont persisté dans une communication classique, à savoir : rigide, verticale et hermétique aux interventions extérieures. Autrement dit, dans une posture de toute-puissance désormais incompatible avec les réalités du marché.
Confiance et proximité
Et surtout, avec les attentes d’un consommateur en quête de balises dans tous les domaines de la société et pour qui il est devenu essentiel d’intervenir, de participer, de voir et de savoir. Non seulement pour reprendre le pouvoir dans le seul domaine où cela lui est encore possible – celui de la consommation – mais aussi et surtout pour se rassurer face à un univers qui, rappelle Cécilia Tassin, directrice associée en charge de stratégie chez BlackandGold, inspire de plus en plus la défiance. “On le sait depuis quelques années déjà et c’est encore plus marquant depuis l’affaire de la viande de cheval : le monde industriel dans son ensemble est perçu comme inquiétant, opaque et désincarné.”
Pour restaurer la confiance, les grandes marques doivent impérativement réintroduire de la proximité, jouer l’empathie et l’affinité. En clair : actionner tous les leviers qui seront susceptibles d’adresser ce message simple et pourtant essentiel au consommateur échaudé : “Regardez, nous n’avons rien à cacher.” D’abord en exploitant au maximum la carte de la transparence – en fournissant autant d’informations que possible sur l’origine des produits, les process de fabrication, etc. (comme le font notamment Danone et McDo), ensuite, on l’aura compris, en permettant au consommateur d’intervenir d’une façon ou d’une autre, et enfin, en usant de l’argument massue du moment : celui de la proximité. Du “made près de chez vous” comme le désigne Cécilia Tassin pour qui cette “prime au local” permet, plus efficacement que toute autre, de rassurer le consommateur en dédiabolisant l’industrie.
Beaucoup l’ont compris, raison pour laquelle on assiste au grand retour des supermarchés au détriment des hypers – symboles du gigantisme et de tous les excès de la mondialisation – à l’explosion de petites marques implantées sur un territoire donné – comme c’est notamment le cas dans le domaine de la bière où les petites brasseries locales comme Galia, la Brasserie de la Goutte d’Or ou De Mori connaissent un succès tel qu’elles commencent à inquiéter les grands groupes – ou encore à celle d’initiatives isolées visant toutes à ancrer l’offre dans du local.
Exemple : le miel “Les Abeilles des toits de Paris” vendu chez Monoprix et produit sur les toits mêmes des magasins de l’enseigne, ou encore l’apparition de potagers sur les toits des grandes surfaces, comme c’est de plus en plus fréquemment le cas aux Etats-Unis, et comme le chef étoilé Yannick Alléno l’a mis en place dans son restaurant “Le Terroir parisien” où chaque plat – chou de Pontoise, pâté Pantin, matelote Bougival… – revendique haut et fort son origine en bordure de périph, conformément aux attendus du moment : savoir d’où cela vient, comprendre comment c’est fait et identifier les bénéfices que cela va m’apporter. Des attentes désormais incontournables auxquelles le fait de jouer l’hyper-local, permet de répondre en ancrant le produit dans une réalité. “Tout à coup, il acquiert une histoire, une origine, on sait qui l’a fabriqué, ce n’est plus du story-telling ! résume Cécilia Tassin avant de corriger : ou plutôt si, mais du story-telling authentique. Pas de la fiction marketing.” Et à l’en croire, mieux vaudra, au cours des prochains mois, saisir la différence.